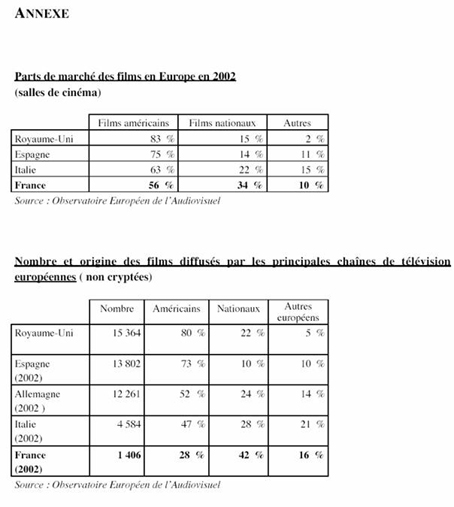Le premier enjeu de la diversité culturelle est donc de reconnaître à la culture le statut d’un
bien qui n’est pas seulement marchand. Mais cette démarche n’a désormais de sens que si elle est
posée au plan mondial.
Mais une fois cette reconnaissance établie, ce qui n’est pas encore le cas, il reste
naturellement à s’intéresser au contenu de cette diversité. Or c’est là que les choses se compliquent,
car les acceptions de la diversité ne sont naturellement pas les mêmes d’une société à l’autre, et la
reconnaissance de toutes les singularités peut déboucher sur un relativisme ravageur. Ces problèmes
commencent à peine à être posés.
Le texte qui suit s’attache à mettre en valeur trois dimensions de ce débat.
Le premier consiste à montrer comment la question de la diversité culturelle s’est construite
politiquement au niveau européen, depuis un peu plus d’une dizaine d’années contre une vision
américaine très clairement opposée à ce principe. Ainsi, des sociétés européennes entretenant des
rapports historiques différents à la culture sont parvenues à défendre une position commune.
Mais défendre un point de vue commun ne suffit pas car l’évolution des technologies et des
rapports de force fait que l’articulation entre le marché et la culture est en permanente renégociation.
C’est la raison pour laquelle la protection de la diversité culturelle n’est jamais stabilisée. C’est
précisément le second angle de ce texte.
Le troisième s’attache enfin à esquisser ce qui sera le véritable enjeu de la diversité
culturelle : celui des contenus. Freiner la concentration de l’offre culturelle, traiter de la diversité
culturelle en Europe à la majorité qualifiée et promouvoir une vraie circulation mondiale des œuvres,
tels sont les objectifs sans lesquels la diversité risque de se transformer en principe général d’autant
plus facilement admis qu’il sera vidé de tout contenu.
On sait à peu près clairement ce que la protection de la diversité culturelle veut empêcher. Il
lui reste encore à prouver ce qu’elle veut et peut promouvoir.
Sommaire
INTRODUCTION
COMMENT L’EXCEPTION EST DEVENUE LA REGLE
 Le premier affrontement euro-américain
Le premier affrontement euro-américain
 De l’exception à la diversité culturelle
De l’exception à la diversité culturelle
 Le redéploiement de la stratégie américaine après l’Uruguay Round
Le redéploiement de la stratégie américaine après l’Uruguay Round
 La révolution de l’information
La révolution de l’information
 Le test de l’A.M.I.
Le test de l’A.M.I.
 La politique du « containment »
La politique du « containment »
LA CULTURE AU RISQUE DU MARCHE
 L’exception n’est pas française
L’exception n’est pas française
 La diversité, valeur universelle
La diversité, valeur universelle
 Culture et mondialisation : deux visions du monde
Culture et mondialisation : deux visions du monde
 L’exception culturelle et l’OMC
L’exception culturelle et l’OMC
 Pourquoi a-t-on besoin d’une convention internationale ?
Pourquoi a-t-on besoin d’une convention internationale ?
PROPOSITIONS POUR UNE POLITIQUE DE CONTENUS
 Prendre en compte la diversité culturelle dans l’examen des projets de concentration.
Prendre en compte la diversité culturelle dans l’examen des projets de concentration.
 Aller plus loin dans le futur Traité de Rome
Aller plus loin dans le futur Traité de Rome
 Favoriser la circulation mondiale des œuvres
Favoriser la circulation mondiale des œuvres
CONCLUSION
ANNEXE
INTRODUCTION
En une décennie la culture est devenue l’un des enjeux majeurs de la mondialisation. La
révolution des transports et des technologies de l’information, l’extension planétaire de la logique
marchande, la constitution de sociétés multinationales dans les industries culturelles de l’audiovisuel,
de la musique et de l’édition ont conjugué leurs effets pour faire de la culture un terrain d’oppositions
entre les Etats. Initialement circonscrit aux pays riches (Etats-Unis, Canada et Europe) en raison de ses
enjeux financiers, le problème a pris après le 11 septembre une signification supplémentaire. Défendre
la diversité culturelle c’est aussi défendre le dialogue interculturel. Certes, l’idée du dialogue entre
civilisations peut sembler galvaudée. Mais l’enjeu est d’importance. L’extension à la culture des
conflits internationaux constitue aujourd’hui un risque politique majeur.
Les relations complexes entre culture et mondialisation se résument à trois séries de questions :
• La mondialisation enrichira-t-elle les cultures ou les banalisera-t-elle ?
• Les Etats garderont-ils la liberté de définir et de mettre en œuvre les moyens réglementaires et
financiers pour protéger et promouvoir leur culture, ou délaisseront-ils tout ou partie de cette
capacité au profit du seul marché ?
• Comment favoriser et réguler le développement équilibré des échanges culturels à travers le
monde, éviter les tendances à l’hégémonie culturelle et les risques de repli identitaire ?
Ainsi posée, la question de « l’ exception culturelle » apparaît avant tout comme un enjeu de politique
mondiale. Elle concerne le rapport entre la norme nationale et la norme internationale. Les Etats qui en
sont les protagonistes agissent en vertu de leurs visions du monde, et donc de leur rapport à la culture.
Or, ce rapport qui varie naturellement d’un pays à l’autre. Dans certains pays la segmentation des
marchés audiovisuels ou musicaux entre œuvres nationales et œuvres américaines, laisse une place
anecdotique à celles des autres pays. Leur position sur l’exception culturelle s’en ressent
naturellement.
Il est dès lors important pour la compréhension du débat d’opérer une distinction entre la règle de
l’exception culturelle, fixée au niveau international, et le contenu d’une politique menée à un niveau
national ou européen qui réserve à la culture un traitement différencié par rapport aux règles du
marché.
Nous allons dans les pages qui suivent mettre en évidence deux points essentiels : montrer comment
s’est forgée cette notion d’exception culturelle et comment elle s’est progressivement affirmée comme
une ligne de partage entre deux conceptions de la culture : l’une européenne, l’autre américaine.
Pourquoi la production de cette norme collective demeurera insuffisante si elle ne prend pas en compte
la question cruciale des contenus. En effet, une règle de droit ne suffit pas, elle doit servir de support à
de véritables politiques culturelles.
COMMENT L’EXCEPTION EST DEVENUE LA REGLE
Contrairement à une idée reçue, la compatibilité entre les systèmes nationaux de politique
culturelle et des normes juridiques internationales (au-delà d’accords bilatéraux) n’est pas nouvelle.
Les négociateurs de l’Accord GATT de 1947 avaient déjà abordé ce sujet et prévu à l’article 4 de cet
Accord une sorte d’exception culturelle avant la lettre, autorisant les Etats membres à instaurer des
quotas pour la diffusion de films nationaux.
La Communauté européenne sera confrontée au problème à l’occasion des discussions difficiles sur
l’adoption de la directive « Télévision sans Frontières » (TVSF) entre 1986 et 1989. Depuis cette date,
l’Europe dispose d’un socle législatif pour la régulation audiovisuelle, qui - en tant qu’acquis
communautaire - contribue à souder la position des Européens dans les négociations de l’Uruguay
Round. Mais la contrepartie de cette cohésion sera la détermination des Américains à le voir
disparaître et à éviter son extension à d’autres régions du monde.
En prenant la tête de la Commission en janvier 1985, Jacques Delors propose aux « dix » Etats
membres de réaliser d’ici 1992 un authentique marché intérieur en supprimant les obstacles aux
échanges et à la circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux. Mais cet objectif
mobilisateur ne se résumait pas à une libéralisation pure et simple. Il s’agissait d’organiser l’espace
européen en créant un cadre législatif au niveau communautaire et de mettre en œuvre des politiques
d’accompagnement. Rien cependant ne fut envisagé pour la Culture et l’Audiovisuel. Or, dans
plusieurs arrêts célèbres rendus sur des affaires impliquant des opérateurs situés dans des pays
différents et mettant en cause des réglementations nationales, la Cour de Justice de la Communauté
avait clairement assimilé l’émission de télévision à un « service » [1] assujettissant ainsi le secteur
audiovisuel au droit communautaire. Comment dès lors appliquer au secteur de la télévision les lois
fondamentales de la libre circulation et de la libre prestation de services ? Comment appliquer le
principe du marché intérieur qui veut que tout service produit dans un pays de l’Union selon les lois de
ce pays ait la possibilité d’être proposé dans les autres pays de l’Union sans aucune intervention des
autorités nationales de ces pays, ni réglementation supplémentaire ? Et donc, comment traiter les
fameux quotas de diffusion et de production destinés à encourager la création et la diffusion d’œuvres
audiovisuelles nationales, qui d’un point de vue économique constituaient des obstacles évidents à la
libre circulation à l’intérieur de l’Union ?
Pour répondre à ces questions, la Commission proposa un dispositif à trois étages : la reconnaissance
de la légitimité des mesures de promotion des œuvres (quotas), la fixation d’un socle de quotas
« européens » obligatoires (qui pouvaient être honorés par des productions nationales), la possibilité
pour les Etats qui le souhaitaient d’aller au-delà du socle européen, en fixant par exemple des quotas
plus élevés ou des quotas linguistiques pour leurs propres diffuseurs.
Cette solution, forgée à l’appui de considérants de la Cour de Justice sur la légitimité des politiques
culturelles nationales, montrait qu’il était possible de concilier objectifs culturels et économiques. Tout
signal de télévision émis à partir d’un Etat membre et respectant la législation de ce pays d’origine
pouvait être reçu et rediffusé dans l’ensemble du marché unique sans autorisation des Etats de
réception. Etant entendu que ce signal devait comporter une majorité d’œuvres européennes.
Cette approche de la Commission, qui reçut à l’origine un soutien critique des pays du sud de l’Europe
et de la Belgique, rencontra l’opposition virulente des autres pays de l’Union. Opposition dont les
raisons mêlaient intérêt économique (certains groupes étaient en train de négocier l’achat massif de
catalogues américains) et problématique institutionnelle (en Allemagne, les Länders compétents pour
l’audiovisuel ne souhaitaient pas voir émerger un pôle de régulation à l’échelle européenne, alors qu’il
n’en existait pas à l’échelle fédérale). Ils porteront d’ailleurs -sans succès- l’affaire devant la Cour
Constitutionnelle de Karlsruhe. D’autres pays enfin, comme le Royaume-Uni, voyaient d’un mauvais
œil ce qu’ils percevaient comme l’extension du domaine de compétences de l’Union, et une atteinte au
libéralisme.
Il s’ensuivit deux ans et demi de laborieuses négociations au terme desquelles fut tracée en 1989 une
« voie européenne » qui prévaut encore aujourd’hui.
Celle-ci repose sur deux piliers : un pilier législatif destiné à organiser la circulation des émissions de
télévision à travers l’Europe (directive TVSF) et un pilier financier consacré au soutien du secteur
audiovisuel. D’où la création du programme Media. Doté à l’origine de 200 millions d’écus pour cinq
ans, il soutiendra des actions de formation des opérateurs européens de l’audiovisuel, de
développement des œuvres audiovisuelles au stade de la pré-production, et surtout de distribution
transnationales (doublage, sous-titrage, marketing) des films de cinéma. Media 2 verra son budget
atteindre 310 millions d’euro. Ces instruments qui font désormais partie de l’acquis communautaire,
facilitent la circulation des créations européennes à l’intérieur de l’Union.
Certes, comme tout compromis, celui réalisé sur TVSF par les ministres des Douze en 1989 créa
quelques frustrations. L’expression « chaque fois que réalisable », à propos des quotas, en atténua le
caractère obligatoire proposé à l’origine par la Commission. Cependant le dispositif retenu
contraignait les Etats à justifier pourquoi - si tel était le cas - ces quotas n’étaient pas atteints et à
prévoir les mesures appropriées pour qu’ils le soient. De plus, l’assiette de ces quotas était quelque peu
élargie.
Mais la légitimité et la légalité des quotas au regard du droit communautaire étaient établies, et les
Etats conservaient la liberté d’aller au-delà du socle fixé par la directive pour les chaînes relevant de
leur compétence.
Une liberté dont une majorité d’Etats a usé, en renforçant le caractère obligatoire des proportions
d’œuvres européennes à atteindre, en resserrant l’assiette et en instaurant d’autres types de quotas en
matière linguistiques ou d’investissements. La France, par exemple a fixé un quota de 60% d’œuvres
européennes dont 40% pour des œuvres d’origine linguistique française.
Un point d’équilibre avait été atteint. Les pays opposés à l’origine aux quotas acceptaient de les
instaurer, ceux qui en disposaient les conservaient. Les délocalisations de radiodiffuseurs attirés par
des Etats au régime plus souples restèrent marginales, contrairement à certains pronostics pessimistes.
Lors de la révision de la directive en 1997, cet équilibre fut préservé et le régime des quotas fut
reconduit tel quel. La révision fut acquise par consensus général alors que le texte pouvait l’être à la
majorité qualifiée.
L’expérimentation d’une relation nouvelle entre norme nationale et norme supranationale affirmait la
spécificité de la culture et la capacité des Etats à la promouvoir. Ce débat eut lieu quatre ans avant que
le sujet soit posé au niveau du GATT. Mais les cadres dans lesquels sont traités ces relations entre
niveaux national et international sont profondément différents. L’Union Européenne inscrit son action
dans une vision politique d’intégration et d’union entre les peuples. Elle affirme une Communauté de
destin. Elle possède des institutions propres, un Parlement élu au suffrage universel dont le pouvoir s’est accru au fil des nouveaux traités qui, par ailleurs, ont tendu à préciser les compétences
respectives des Etats et de l’Union à travers le principe de subsidiarité. Le GATT (qui deviendra
l’OMC) est limité à celle d’une organisation intergouvernementale dont la seule mission est d’assurer
une libéralisation toujours plus poussée du commerce international.
Le premier affrontement euro-américain
Le 15 avril 1994, les ministres des 117 pays membres du GATT signent l’acte final de
l’Uruguay Round. L’accord le plus ambitieux de l’histoire du commerce international est conclu avec
pour la première fois une extension de la libéralisation aux services. Et, pour en assurer la bonne
application, l’Organisation Mondiale du Commerce était créée.
Cet accord ne fut pas atteint sans mal. Les Américains qui avaient libéralisé leur audiovisuel au début
des années 1990, après avoir acquis une position dominante sur le marché mondial, exigèrent au début
de l’année 1993 une extension des règles à ce secteur. Cette application aurait eu pour effet de faire
voler en éclats tous les dispositifs nationaux et européens de soutien et de promotion des œuvres
audiovisuelles, que ce soient les dispositifs réglementaires (quotas), les mécanismes d’appui financier
ou que les accords de coopération conclus entre des pays qui souhaitent développer leurs échanges
audiovisuels. Bref, tout ce qui représentait un obstacle au libre jeu du marché devait, pour les
Américains, être démantelé.
Il ne s’agissait pas alors de la part des Etats-Unis, comme on a pu le dire, d’une manœuvre tactique
visant à introduire un élément de plus dans le jeu de la négociation globale de l’Uruguay Round.
L’audiovisuel est devenu le poste qui dégage le plus d’excédents dans la balance commerciale
américaine, et le film ou la série télévisée made in Hollywood véhicule l’image et les produits de la
société américaine. La demande de 1993 rejoignait donc une constante de la stratégie américaine,
réactivée en partie par les nouvelles ambitions de l’Europe dans ce secteur. L’offensive américaine
dans les négociations de l’Uruguay Round se doublera d’ailleurs durant la même période d’une action
diplomatique vigoureuse auprès des gouvernements des pays européens de l’ancien bloc soviétique,
pour les mettre en garde contre toute tentative d’adopter les mesures de la directive TVSF.
Au cours de cette année 1993, Jack Valenti, le puissant président de la Motion Picture Association of
America, refusa d’envisager des accords de libéralisation qui ne couvriraient pas l’audiovisuel. Le
représentant américain pour le commerce parle des quotas comme d’un « cancer commercial ».
D’abord décontenancée, la Communauté européenne finit par entrer dans le débat, à l’instigation du
gouvernement français. Le travail pédagogique et de sensibilisation effectué par les cinéastes français
et européens révéla à l’opinion, mais aussi à bon nombre de politiques peu familiers des questions
commerciales internationales, le véritable enjeu de l’Uruguay Round pour l’audiovisuel et la culture.
Il faudra plusieurs mois à la Communauté pour arrêter une position, la défendre et finalement
l’emporter. Les discussions au sein de la Commission, entre la Commission qui négocie et le Conseil
des ministres qui lui fixe un mandat de négociation, en contrôle le respect et valide l’accord furent
pour le moins nourries. Au sein de la Commission, Jacques Delors batailla ferme pour la fixation d’un
mandat sur cette question. Le mandat fut élaboré sur la base d’un refus du statu quo qui aurait signifié
que les Etats-Unis acceptent le maintien des quotas et les subventions à l’audiovisuel, mais à leur
niveau de 1993.
Autrement dit, l’Europe aurait dû renoncer à toute faculté d’améliorer ou de renforcer ses systèmes de
promotion des œuvres audiovisuelles nationales et européenne. Une telle perspective était non
seulement contraire aux dispositions que venait d’adopter la Communauté dans la directive TVSF.
Mais elle aurait annulé la capacité des Etats membres à adopter des mesures allant au-delà de la norme
européenne.
Le Parlement européen vote, quant à lui en 1993, deux résolutions demandant un traitement spécifique
des questions audiovisuelles, puis un traitement d’ « exception ». Le Conseil des ministres, présidé ce
deuxième semestre 1993 par une Belgique imaginative et d’une totale fermeté, adopta un « socle » de
principes qui resteront comme les six points de Mons.
Ils valent la peine d’être rappelés :
1. Exemption ad hoc à la clause de la « Nation la plus favorisée » afin de maintenir les relations
privilégiées des pays européens avec des pays tiers à l’Union ;
2. Maintien et développement des régimes d’aides et de subventions ;
3. Liberté de réglementer les modes de transmission existant et les nouvelles technologies de la
communication ;
4 . Liberté de développer toute politique d’aide au secteur audiovisuel, dans tous ses aspects
(création, production, diffusion, radiodiffusion, distribution et exploitation) ;
5. Absence de soumission du secteur audiovisuel au principe de libéralisation progressive,
6. Maintien de l’acquis communautaire, dont la mise en œuvre effective de la Directive « TVSF ».
Sur cette base, l’Union sut définir et faire prévaloir sa position. Selon les termes de l’accord clôturant
l’Uruguay Round, la situation du secteur de l’audiovisuel se présentait ainsi :
Le secteur audiovisuel n’est pas exclu de l’Accord sur les services (AGCS), mais l’Union Européenne
a réussi à ne prendre aucun engagement de libéralisation dans le domaine de l’audiovisuel au titre de
deux disciplines de l’AGCS. La première est celle du traitement national qui oblige les signataires de
l’accord à accorder à tous les fournisseurs de services, quelle que soit leur nationalité, le même
traitement qu’aux fournisseurs de services nationaux. Si ce traitement national avait été appliqué à
l’audiovisuel, les films américains et autres auraient, par exemple, bénéficié des mécanismes de
soutien financier nationaux et européens, dans les mêmes conditions que les films européens. La
seconde discipline est celle de l’accès au marché qui oblige les signataires de l’accord à s’abstenir de
toute restriction quantitative aux échanges et de toute mesure susceptible d’affecter le chiffre d’affaires
ou la valeur des actifs des entreprises des pays partenaires, et à accorder à tous les fournisseurs de
services, quelle que soit leur nationalité, le même traitement qu’aux fournisseurs de services
nationaux. Autrement dit les quotas de diffusion d’œuvres européennes auraient dû être supprimés.
Enfin, l’Union a retenu cinq exemptions à la clause dite de la nation la plus favorisée (NPF). Cette
clause veut qu’un signataire de l’accord étende à tous les autres signataires tout avantage commercial
qu’il aurait consenti seulement à certains d’entre eux. L’avantage conféré aux pays du Conseil de
l’Europe, dont les œuvres audiovisuelles sont inclues dans les quotas communautaires de la directive
TVSF devrait en application de cette clause NPF être accordé à l’ensemble des pays. Ce qui une fois
encore viderait le mécanisme des quotas de tout sens. Les exemptions retenues concernent les services
audiovisuels, leur production et leur distribution quelle que soit la forme de transmission vers le
public.
L’Union et ses Etats membres gardaient donc leurs marges de manœuvre pour promouvoir la création,
la production et la diffusion d’œuvres audiovisuelles. La bataille était remportée.
De l’exception a la diversité culturelle
Mais de quelle bataille s’agissait-il ? Celle de l’exception ou celle de l’exclusion ? Au cours
des discussions menées entre Européens pour trouver un point d’accord, différentes positions s’étaient
exprimées. Mais avec un certain recul, on peut rétrospectivement penser que ces divergences n’étaient
pas fondamentales. L’élément le plus important était malgré tout la réalisation d’un certain consensus
sur la place de la Culture.
Faire de la culture une exception au sens de l’AGCS, aurait signifié que les pays signataires de
l’accord auraient pu prendre des mesures contraires aux règles générales de cet accord pour
promouvoir leur culture. Mais ce faisant, ils auraient ouvert la voie à des contentieux dont l’issue
aurait été fixée à travers les mécanismes de règlement des conflits de l’OMC. Les panels de l’OMC
réunis pour juger de ces conflits auraient ainsi été amenés à décider si les « mesures contraires aux
règles générales » prises par un Etat en faveur de sa culture étaient bel et bien justifiées. Ce qui
revenait in fine à faire définir par l’OMC et selon une approche commerciale, ce qui était culturel et ce
qui ne l’était pas. Prenons l’exemple de la télévision publique. Un pays voulant favoriser l’expansion
de ses diffuseurs privés aurait pu porter plainte à l’OMC contre l’existence d’un service public de
télévision financé par des fonds publics. Et plus précisément attaquer le financement mixte de
certaines télévisions publiques (redevance et publicité) entraînant ainsi une concurrence jugée déloyale
sur le marché publicitaire. Reviendrait alors à l’OMC de décider ce que devrait être une télévision de
service public et les modalités de son financement. C’est à ce genre de situation risquée que conduisait
l’approche de l’exception.
A cet égard l’exclusion était a priori plus cohérente. Cette solution revenait à faire sortir le secteur
audiovisuel du champ d’application de l’OMC et de l’accord sur les services. Ses partisans citaient en
exemple l’accord de Libre échange conclu entre les Etats-Unis et le Canada en 1988 (l’Alena) qui, à la
demande du Canada, prévoyait l’exclusion des industries culturelles. Cependant, cet exemple
n’apparaît guère probant dans la mesure où une phrase ambiguë était accolée à celle sur l’exclusion
culturelle : « chaque partie pourra prendre des mesures d’effet commercial équivalent, en réaction à
des interventions incompatibles avec le présent traité ». Autrement dit les Etats-Unis se réservaient une
capacité de rétorsion si des mesures canadiennes prises en faveur de la promotion de la culture
canadienne touchaient leurs intérêts.
« La clause culturelle de l’Alena soulève de sérieux problèmes, écrit le professeur Ivan Bernier, le
grand spécialiste canadien de la diversité culturelle, dans son rapport à l’Assemblée nationale du
Québec (mars 2000). Elle ne devrait définitivement pas servir de modèle aux autres accords
commerciaux... Elle rend inévitable la reconnaissance d’un droit à des mesures d’effet commercial
équivalent pour l’Etat qui subit un préjudice du fait de son utilisation. L’exercice de ce dernier droit
échappant lui-même pratiquement à tout contrôle. La clause a eu surtout pour effet, de dissuader le
Canada de recourir à des mesures incompatibles avec l’Alena. Ce qui, dans le cas du cinéma, l’aura
amené à renoncer à toute intervention concernant la distribution des films, et dans le cas des
périodiques, à accepter un règlement avec les Etats-Unis que certains ont décrit comme une pure et
simple abdication ».
La limite de l’exclusion est là : elle replace le traitement des échanges culturels dans le cadre bilatéral
qui donne évidemment une prime au plus puissant des deux partenaires, sans pour autant d’ailleurs éviter que -comme dans le cas de l’exception- des recours puissent être exercés au sein de l’OMC contre telle ou telle mesure « culturelle » d’un Etat membre.
L’Uruguay Round ne déboucha donc ni sur l’exception ni sur l’exclusion culturelle, ni même sur la
« spécificité » proposition floue abandonnée à la fin de 1993. Mais le résultat eut pour mérite de
sauvegarder la capacité de l’Union et de ses Etats à développer leurs instruments de politique
audiovisuelle. De fait, de nombreuses initiatives dans le domaine de la politique audiovisuelle virent
le jour en Europe depuis la signature de l’Accord de Marrakech sans que l’OMC ou les autres Etats
membres de l’OMC n’aient trouvé à y redire. Au niveau européen, fut arrêté un nouveau programme
« Media Plus » augmenté de 30% pour un budget de 400 millions d’euro sur cinq ans. Plusieurs pays
renforcèrent leurs systèmes de quotas (l’Italie et l’Espagne instaurèrent des quotas d’investissement en
faveur du cinéma) et améliorèrent leurs systèmes d’aide en faveur du cinéma. De nouvelles chaînes de
télévision publique furent créées.
Parce que ces différentes notions prêtaient souvent à confusion, une autre apparut et s’imposa
progressivement : celle de la « diversité culturelle ». Certains considérèrent que ce glissement
sémantique marquait un abandon quant au traitement exceptionnel qui devait être réservé à la culture.
Au sens de la relation entre la norme nationale et internationale, cette objection n’est pas fondée. Car,
pour l’Europe cette notion n’a rien d’incantatoire. En 1995, elle a été intégrée à l’initiative de la
Belgique au Traité d’Amsterdam au chapitre Culture. Là où il était écrit que la Communauté tenait
compte des aspects culturels dans la mise en œuvre de ses politiques, les Belges firent ajouter « afin
notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures. » Conjuguée à la règle de la
subsidiarité qui veut que la culture demeure de la prérogative première des Etats membres, cette
disposition sur la « diversité » considérée comme une « obligation juridique » par les Institutions de
l’Union, devait être désormais mise en pratique par les autres politiques de l’Union et notamment la
politique de concurrence et la politique commerciale.
Que la notion de « diversité » ait été portée par les « petits pays » de l’Union n’a en soi rien
d’étonnant. S’ils jouèrent un rôle actif dans l’affrontement de 1993 et dans la promotion de cette
« diversité » c’est que, dans leur majorité, ils se sentaient plus vulnérables aux effets d’uniformisation
culturelle de la mondialisation que des pays plus grands qui disposent d’industries culturelles et de
télévisions à rayonnement international. Par ailleurs, c’est à l’instigation des Pays-Bas que sera inséré
dans le même Traité d’Amsterdam un protocole précisant les prérogatives des Etats membres de
l’Union quant à la définition des missions du service public de télévision, son organisation et son
financement.
Le redéploiement de la stratégie américaine après l’Uruguay round.
L’affrontement sur la culture auquel donna lieu l’Uruguay Round s’achèva donc au bénéfice
des Européens et des Canadiens. Une très large majorité d’Etats membres de l’OMC les suivirent en
ne prenant aucun engagement de libéralisation de leur secteur audiovisuel. Dix Etats contractent des
engagements partiels et deux Etats seulement ouvrent totalement leur marché : les Etats-Unis et la
République Centrafricaine.
Cependant l’affrontement se poursuivit sous d’autres formes et en d’autres lieux. Il était certes positif
que le dialogue reprit avec les Américains. Mais sous des déclarations d’amitiés apaisantes et
conciliantes, « le GATT est derrière nous, construisons l’avenir. Nous voulons être vos alliés, vos partenaires. Nous sommes tous sur la barque de la création » (J.Valenti), se profile bientôt une
nouvelle stratégie américaine.
Une note du département d’Etat d’avril 1995 « US Global Audiovisual Strategy » tirant les leçons du
différend avec l’Europe, résume les nouveaux objectifs politiques des Etats-Unis :
• privilégier la recherche d’accords sur des intérêts communs
• améliorer les conditions d’investissement pour les firmes américaines en libéralisant les
régulations existantes
• éviter un renforcement des mesures restrictives comme les quotas et veiller à ce que ces
mesures ne s’étendent pas
• lier les questions audiovisuelles au développement de nouveaux services de communication et
de télécommunication
• rechercher le soutien aux positions américaines des opérateurs européens gênés par les quotas
ou les réglementations (télévisions privées, publicitaires, opérateurs de télécommunication..).
Pour atteindre ces objectifs, la nouvelle stratégie américaine utilisa trois supports : l’Internet et les
enceintes multilatérales que sont l’OCDE et l’OMC.
La révolution de l’information
L’argument américain était relativement simple. La technologie du numérique devant
remplacer, tant dans le secteur des télécommunications que dans celui de l’audiovisuel, la technologie
analogique, la « frontière » entre ces deux secteurs tendrait à disparaître. Du même coup, la spécificité
des réglementations et des systèmes de régulation attachés à chacun de ces secteurs ne serait plus
justifiée. Un monde de libre communication devait naître, mettant le producteur directement en
relation avec le consommateur et offrir à ce dernier une multitude de choix de produits audiovisuels.
« La révolution du numérique exige une approche de marché libre : satellites, fibres optiques,
numérisation créent une nouvelle situation donnant au consommateur le choix ultime des programmes
qu’il souhaite voir... Il est donc raisonnable de suivre pour l’audiovisuel une politique de
dérégulation. » (Jack Valenti). On passait ainsi d’une situation d’offre limitée de services audiovisuels
à laquelle il était possible d’imposer des contraintes législatives, à une situation d’offre illimitée,
pratiquement incontrôlable où toute règle d’ordre public spécifique se serait avérée sans effet.
L’association Ectel (European Telecommunications and professional Electronics Industry) basée à
Londres adressait un mémorandum dans ce sens aux Commissaires européens dans lequel il était dit
qu’ « avec la convergence technologique vient la convergence du marché. Mais aucun marché ne peut
décoller s’il est régi par des règles différentes, imposées par des institutions différentes. Ainsi une
convergence des régulations de l’audiovisuel et des télécoms, et leur simplification est-elle
absolument nécessaire. »
 Réglementations a minima ?
Réglementations a minima ?
Cette position s’affirma dès la fin de 1994, quelques mois après la fin de l’Uruguay Round,
lors de la révision de la directive TVSF. Lors des travaux préparatoires, l’Administration américaine
se livra à une véritable offensive en Europe (notes, démarches appuyées de l’Ambassadeur américain
auprès des Commissaires, tournée d’officiels américains dans les capitales) sur le thème : la Commission va proposer la révision d’un texte condamné, obsolète. Non seulement les quotas sont
inefficaces (une multinationale nippo-américaine avait produit une étude sur la question), mais ils
deviendront rapidement inopérants en raison de la révolution technologique.
Le débat fut vif entre les différents services de la Commission, dont certains annonçaient la disparition
de la télévision classique avant la fin de l’an 2000 au profit de la vidéo à la demande et de l’Internet, et
donc réclamaient l’abrogation de la directive TVSF.
Argument contre argument, les tenants de la régulation audiovisuelle européenne démontrèrent que la
spécificité de la réglementation audiovisuelle ne tenait pas à la rareté de l’offre, mais à des
considérations d’intérêt général et que l’objectif de la diversité culturelle faisait partie de ces
considérations au même titre que la protection des mineurs, la protection du droit des auteurs ou du
droit des consommateurs (pour les règles touchant la publicité). En outre renoncer à une régulation des
services télévisés pour laisser en suspens la réglementation à appliquer à des nouveaux services
audiovisuels à peine émergents, aurait créé de l’insécurité juridique pour les opérateurs et gêné le
développement du secteur audiovisuel lui-même.
Ainsi, si les quotas étaient supprimés au niveau européen, le système des quotas nationaux aurait de
facto été fragilisé et attaqué devant la Cour de Justice pour entrave au marché. La « guerre des
quotas » aurait été réouverte, moins d’un an après la fin de l’Uruguay Round. Enfin, on ne disposait
d’aucune indication quant au rythme auquel ces nouveaux services audiovisuels allaient s’imposer.
Dans leur sagesse, et sur l’initiative du Commissaire à la Culture, les membres de la Commission
adoptèrent une proposition de modification de la directive TVSF maintenant la préférence européenne
(quotas).
 Comment l’exception culturelle est retournée à l’OMC
Comment l’exception culturelle est retournée à l’OMC
Mais le débat sur la « convergence » n’était pas pour autant épuisé. Il rebondit en 1997 à
l’OMC avec les négociations portant sur la libéralisation des télécommunications de base qui
n’avaient pu être finalisées dans l’Accord de l’Uruguay Round. C’est pourquoi les Etats membres de
l’OMC s’étaient donnés un délai supplémentaire pour aboutir : le 15 février 1997. Il ne fut pas
étonnant à cette occasion de voir les Etats-Unis repartir à la charge pour demander d’inclure les
services audiovisuels (notamment la vidéo à la demande) dans la négociation afin de les libéraliser.
Ainsi la question de la frontière entre audiovisuel et télécommunication était posée à l’OMC sur fond
de convergence technologique. Cette question contenait un piège évident car la traiter revenait à
définir précisément ce qu’au terme de l’AGCS on entendait par « audiovisuel » et, partant de là à
restreindre le champ des non-engagements de libéralisation pris par l’Europe dans l’Accord de
Marrakech.
Dans cette négociation, la Communauté veilla à préserver l’acquis du cycle de l’Uruguay. Plutôt que
de s’engager sur la piste dangereuse des définitions, la Commission proposa d’établir une distinction
entre les services ayant pour objet de transporter des signaux électroniques et les services offrant un
contenu audiovisuel. La libéralisation pouvait donc concerner le transport des signaux (images et son)
mais en était exclue la radiodiffusion (télévision) classique ainsi que tout service offrant un contenu
qui n’avait pas été libéralisé. Ainsi faisait-on prévaloir la position acquise à Marrakech.
Cette position l’emporta et le Conseil approuva l’accord sur les télécommunications de base, négocié
par la Commission. Mais pour bien marquer l’importance de cette affaire, la Belgique soutenue par la
France, l’Italie et la Grèce fit acter que « le résultat des négociations ne modifie aucunement le statut ni la portée des services audiovisuels et culturels tels que prévus à l’égard de l’OMC et de l’accord
AGCS. »
 Marx est mort, tout est possible
Marx est mort, tout est possible
Il serait évidemment difficile de nier la réalité et les potentialités de la révolution du
numérique et de l’Internet pour la société et le secteur de l’audiovisuel. La question n’est pas là. Elle
est dans le fait que cette « révolution » a été instrumentalisée par une idéologie qui depuis
l’effondrement du communisme ne voyait plus de limite à son développement. « Marx est mort, tout
est possible » pourrait-on dire en paraphrasant Dostoïevski. Il en résulta dans les années 1995-2000
une littérature très idéologique, selon laquelle la nouvelle révolution de l’Internet, fondée sur la seule
logique du marché allait résoudre tous les problèmes de la planète : éducation, santé, emplois,
croissance économique...
Dans le domaine de la société de l’information, la « convergence » allait voir se constituer des groupes
géants réunissant services de contenants et de contenus sur le modèle de AOL Time Warner ou de
Vivendi Universal offrant un choix infini d’images au consommateur. Sans insister sur les
contradictions de la démonstration qui consistait à célébrer l’économie décentralisée que constituait la
net-économie et annoncer l’émergence de multinationales régnant sur plus des deux tiers du marché,
on pourra avec le recul simplement rappeler que si le marché est indispensable, il est aveugle.
L’erreur la plus grave a été commise sur le rythme et la nature du changement. Imaginer un
bouleversement radical et immédiat de l’économie de l’audiovisuel avec une concentration des usages
sur l’audiovisuel à la demande, au détriment de la télévision « classique » et notamment des chaînes
généralistes (dont était annoncée la disparition), et aussi des autres pratiques telles que la locationvidéo
était peu crédible. Et l’exigence d’une dérégulation de l’audiovisuel pour favoriser l’avènement
de cette nouvelle ère constituait une démarche pour la moins hasardeuse. Au demeurant l’évolution de
l’audiovisuel particulièrement dynamique depuis une dizaine d’années réserva d’autres tendances que
celles annoncées : la multiplication des chaînes « classiques », l’Europe passant en cinq ans de 400 à
800 chaînes, la remontée de la fréquentation des salles de cinéma, le succès spectaculaire du DVD
(vente et location), la vidéo à la demande ou la télévision interactive, ne représentant encore qu’une
part infinitésimale du paysage audiovisuel.
Dès lors la position prise par la Commission dans son Livre vert sur la convergence de 1998 (qui
donna lieu à quatre versions successives jusqu’à ce que le Commissaire à l’audiovisuel obtienne gain
de cause) et par les ministres de l’audiovisuel s’avéra pertinente. L’Union européenne convint en
1999-2000 que la régulation de l’audiovisuel à l’ère numérique devait être abordée de façon
pragmatique et selon des principes suivants :
• séparation de la réglementation du transport (contenant) et de celle du contenu,
• neutralité technologique, autrement dit la même réglementation doit s’appliquer au même
contenu quel que soit son mode de distribution,
• respect des intérêts généraux de la société : protection des mineurs, droits des auteurs,
diversité culturelle,
• légitimité du service public de télévision qui, pour remplir ses missions doit lui aussi
bénéficier des potentialités de l’ère numérique.
Ainsi l’approche d’un traitement spécifique des questions audiovisuelles par l’Europe était-elle
maintenue.
Le test de l’A.M.I. (Accord Multilatéral sur l’Investissement)
En mai 1995 s’engage à Paris au château de la Muette une négociation entre les 29 pays
membres de l’OCDE en vue d’un accord multilatéral destiné à instaurer des règles de libéralisation et
de protection de l’investissement direct étranger. Cet accord devait être ouvert aux pays non-membres
de l’OCDE. Les promoteurs de cette démarche voulaient offrir aux investisseurs transnationaux un
cadre assurant la visibilité des conditions de leurs opérations et la sécurité des investissements réalisés.
Les principes préconisés s’apparentaient à ceux de l’OMC et notamment : le traitement national
(traitement des investissements non nationaux identique aux investissements nationaux) ; l’application
de la clause de la nation la plus favorisée et enfin l’interdiction des obligations de résultat
(performance requirements) telles que les quotas. Appliqué à l’audiovisuel cet accord aurait permis
d’obtenir par le biais des investissements ce qui avait été refusé à l’OMC pour les services. C’est-à dire
que les filiales des majors d’Hollywood implantées dans un pays de l’Union auraient pu avoir
accès aux mécanismes de soutien au cinéma de ce pays et à ceux de l’Union (programme Media) et
que les quotas de diffusion auraient été démantelés. Ainsi les politiques audiovisuelles nationales et
européennes auraient été vidées de sens. De même qu’auraient été mises en cause les règles nationales
qui prévoient la limitation des prises de participation étrangères dans le capital des sociétés de radio et
de télévision.
Le projet d’AMI ne prévoyait aucune exception non plus sur les questions de propriété littéraire et
artistique. Et les auteurs et leurs sociétés étaient en droit de s’inquiéter de l’impact de cet accord sur
les accords qui venaient d’être conclus (décembre 1986) au sein de l’Organisation Mondiale de la
propriété intellectuelle qui confortaient l’approche européenne de la protection des droits des auteurs.
Aux termes de l’AMI, un investisseur acquérant des droits dans un autre pays aurait pu faire valoir
qu’il n’était pas en mesure d’en tirer le profit maximum escompté en raison des dispositions nationales
protégeant les auteurs, et donc mettre en cause ces dispositions.
En effet, si le principe du traitement national a été reconnu par les Conventions et les accords
internationaux sur les droits d’auteur, c’est d’une part parce qu’existaient entre les pays signataires des
niveaux de protection des auteurs à peu près équivalents et que, par ailleurs, ce principe était assorti
d’un socle de dispositions obligatoires portant sur la reconnaissance de droits fondamentaux
(communication, reproduction, durée des droits..). Or rien de tel n’était prévu dans l’AMI, les droits
d’auteur étant assimilés à des investissements comme les autres.
Enfin le projet prévoyait d’instituer des procédures de recours pour les entreprises s’estimant lésées
par telle ou telle mesure discriminatoire (envers les investissements non nationaux) existant dans le
pays où elles avaient investi. Contrairement à l’OMC où les voies de recours sont ouvertes aux seuls
Etats, n’importe quel acteur économique aurait pu en quelque sorte traduire un Etat en justice.
Le projet d’Accord Multilatéral sur les Investissements de l’OCDE commença à susciter à partir de
1996 des oppositions au sein de l’OCDE entre les Etats participant aux négociations et parmi les
acteurs de la société civile. Touchant tous les secteurs de la vie économique, il mettait en cause audelà
de la culture et de l’audiovisuel, les différentes politiques sociales, sanitaires et
environnementales menées par les Etats et la capacité de ces Etats à approfondir ces politiques. Sur la culture, une discussion vive s’engagea. La France appuyée d’abord par le Canada puis par la
Belgique, l’Italie, le Portugal et la Grèce, réclama l’application de l’exception culturelle. Les Etats-
Unis et le Japon eurent alors pour stratégie d’en limiter le champ. A l’extérieur le débat s’engagea non
seulement sur la culture mais aussi sur l’environnement et le social. Les premières à réagir furent les
associations américaines de consommateurs et de protection de l’environnement, les associations
professionnelles de l’audiovisuel canadiennes, françaises et européennes. Ces dernières se
mobilisèrent auprès des Institutions communautaires, et notamment de la Commission et du Parlement
européen qui organisa plusieurs auditions avec des organisations professionnelles européennes
particulièrement actives.
En février 1998, décision fut prise d’ajourner les travaux. Les Américains rejetèrent sur les Européens
la responsabilité de cet échec. Ils jugèrent exorbitantes leurs demandes relatives à l’ajout d’une
« clause d’intégration régionale » (afin de permettre à l’Union de poursuivre son intégration
économique et de développer ses politiques), au respect de l’acquis AGCS/OMC en matière
audiovisuelle, y compris donc la capacité pour l’Union et ses Etats membres de renforcer leurs
dispositifs de promotion de leur culture s’ils l’estimaient nécessaire et l’exclusion des investissements
dans les domaines d’ordre public.
En réalité les parties participantes avaient des demandes irréconciliables. Les Américains n’étaient pas
en reste et voulaient, par exemple, se réserver le droit de refuser l’accès des investisseurs étrangers à
leurs subventions et marchés publics. Ce qui constituait une exception considérable. Les Etats-Unis
souhaitaient d’autre part ne pas aliéner leur capacité de punir les firmes étrangères qui effectueraient
des investissements étrangers dans les pays qu’ils estimaient « hors la loi » (Cuba : loi Helms Burton,
ou Iran : loi d’Amato), procédé que les Européens avaient toujours contesté.
Au moment où les négociations devaient reprendre, en octobre 1998, le Premier ministre Lionel Jospin
décida que la France n’y participerait pas. La réunion à l’OCDE ne dura que quelques heures et aucun
nouveau rendez-vous ne fut fixé.
La politique du « containment »
Le projet d’AMI avait une vocation généraliste et ne visait pas expressément la culture et
l’audiovisuel. Mais sa mise en œuvre aurait signifié la fin de l’exception culturelle. L’OCDE offrit un
autre terrain d’action particulièrement propice pour la mise en œuvre de la stratégie audiovisuelle des
Etats-Unis après l’Uruguay Round qui s’y déploya comme elle se déploya vis-à-vis des pays candidats
à l’Union européenne et à l’OMC. Cette stratégie, on l’a vu, avait notamment pour but d’éviter l’effet
de contagion de la politique européenne des quotas. Elle était d’une grande simplicité : convaincre les
pays candidats à l’OCDE et à l’OMC de libéraliser leur audiovisuel et au besoin l’exiger pour avoir
l’accord de Washington à leur entrée dans ces organisations.
Les anciens pays communistes constituaient à cet égard une priorité, puisqu’ils étaient candidats à
l’Union et en passe d’intégrer l’acquis communautaire (et donc la législation audiovisuelle européenne
avec ses quotas) dans leur législation interne. Aussi l’Administration américaine multiplia-t-elle les
démarches auprès de ces pays avec un double message :
1. l’adoption de la directive TVSF déplairait fortement aux Etats-unis qui ont tant fait pour aider
votre pays à sortir du communisme et qui sont les acteurs les plus sûrs de votre sécurité,
2. cette directive est de toute façon condamnée à terme, d’une part parce que les Etats membres de
l’Union européenne sont divisés sur son utilité, et d’autre part parce que d’ici votre accession à
l’Union dans six ou sept ans, elle sera complètement dépassée par les évolutions technologiques.
Ce message diplomatique fut relayé par de fortes pressions politiques :
• à l’égard des pays candidats à l’OMC, pour exiger d’eux - comme condition pour adhérer à
cette Organisation - la libéralisation de leur secteur audiovisuel, et donc là aussi le
renoncement à toute mesure de promotion de leurs œuvres audiovisuelles par le biais de
quotas. Tous les pays candidats à l’Union qui n’étaient pas membres de l’OMC à la fin de
l’Uruguay Round subirent des pressions de ce type.
• à l’égard des pays qui souhaitaient adhérer à l’OCDE dont le « code des invisibles » prévoit
l’élimination des restrictions et discriminations entre Etats membres et l’extension des
mesures de libéralisation à tous les autres Etats membres de l’OCDE.
Il s’ensuivit - particulièrement en 1998 - un bras de fer musclé entre l’Administration américaine et la
Commission qui, dans le processus d’adhésion à l’Union européenne, a pour mission de s’assurer que
les pays candidats reprennent intégralement l’acquis communautaire. Cette reprise doit évidemment
intervenir dans le processus d’adhésion pour qu’à la date d’adhésion, le nouveau pays membre et les
anciens soient sur un pied d’égalité.
Les engagements et renoncements des pays candidats à ne pas intégrer la législation audiovisuelle
européenne et en particulier la directive TVSF créaient des difficultés sur la route de l’élargissement.
Après avoir failli faire échouer l’Uruguay Round, après avoir contribué à couler le projet d’AMI,
l’audiovisuel allait-il devenir l’un des obstacles majeurs aux retrouvailles de la famille européenne ?
Le bras de fer commença par révéler une faiblesse côté européen. En adhérant à l’OMC, la Roumanie,
avait pris l’engagement d’appliquer la clause de la nation la plus favorisée, sans mentionner les
restrictions à cette clause pour l’audiovisuel comme l’avait fait l’Union européenne. Aussi quand le
ministre roumain Caramitru présenta début 1998 au Parlement un projet de loi sur l’audiovisuel qui
notamment intégrait les dispositions de la directive TVSF, le gouvernement roumain fit l’objet d’une
protestation officielle de la part des Etats-Unis.
Dans le cas de la Roumanie qui fut l’un des premiers pays de l’est communiste à adhérer à l’OMC, les
Américains avaient tiré les premiers. Mais la leçon porta et la vigilance des Européens ne fut plus prise
en défaut.
A la fin octobre 1997, une délégation du gouvernement letton se rendit à Washington pour finaliser les
négociations de ce pays à l’OMC. Alors que les travaux progressaient, les Américains haussèrent
soudainement le ton pour signifier à leurs interlocuteurs que les Etats-Unis voteraient contre l’entrée
de la Lettonie à l’OMC si son offre d’adhésion devait maintenir le régime spécial réservé à
l’audiovisuel. Le même message fut envoyé aux deux autres pays baltes également candidats à
l’OMC, l’Estonie et la Lituanie qui négociaient leur adhésion à Genève.
L’entrée à l’OMC se faisant à l’unanimité, la Commission européenne rappela à son tour aux autorités
des trois pays baltes que s’ils acceptaient les conditions américaines, l’Union pourrait reconsidérer sa
position sur leur adhésion à l’OMC. Céder aux Américains serait en outre tourner le dos à l’acquis
communautaire et agir en contradiction avec leur demande d’adhésion à l’Union européenne. Or les
négociations d’adhésion notamment sur le chapitre audiovisuel allaient bon train, les pays baltes ayant
exprimé leur accord sur les objectifs et les moyens de la politique audiovisuelle européenne.
Les échanges entre les services de la Commission et de l’Administration américaine (USTR) n’ayant
pas permis de débloquer l’affaire, les Commissaires européens Brittan et Van den Broek écrivirent au
Secrétaire d’Etat Madeleine Albright en soulignant que « l’insistance américaine pour des
engagements de libéralisation sur l’audiovisuel met en cause la capacité des Etats baltes de participer
pleinement à la stratégie d’accession à l’Union européenne »
Le président de la Commission M. Jacques Santer prit ensuite l’initiative le 14 janvier 1998 d’en saisir
directement le Président Clinton : « les trois Etats baltes entendent rejoindre l’Union européenne
aussitôt que possible. Dans cette perspective, ils devront appliquer pleinement la législation
européenne. Ils ne peuvent donc faire aucun engagement qui irait au-delà de ce que l’Union
européenne a accepté à l’OMC et qui est le résultat des négociations de l’Uruguay Round ».
Il faudra encore six mois de négociations sous la vigilance du Commissaire à l’audiovisuel M. Oreja
pour que l’Union obtienne finalement gain de cause dans ce qu’on a appelé « le compromis balte sur
l’audiovisuel ». Les trois pays baltes reprirent dans leur offre d’entrée à l’OMC les exemptions
européennes à la clause NPF sur l’audiovisuel, et acceptèrent de libéraliser les seuls achats de salles de
cinéma et de videoshops. Ce qui n’était pas une nouveauté puisque ces offres avaient déjà été actées
dans un accord bilatéral passé entre ces pays et les Etats-Unis.
Au total sur les douze pays candidats à l’Union européenne et à l’OMC, dix d’entre eux s’alignèrent
quasi intégralement sur la position européenne et gardèrent la capacité d’intégrer l’acquis
communautaire dans la perspective de leur adhésion à l’Union. Seules la Roumanie et Malte furent
différemment inspirés.
Mais le feuilleton du conflit Etats-Unis Europe ne s’arrêta pas au cercle des pays qui avaient déposé
leur candidature à l’Union. Il se prolongea (et se prolonge encore) avec les adhésions à l’OMC de
nouveaux Etats. Les pressions américaines se sont exercées sur les pays qui sont appelés à devenir un
jour membres de l’Union européenne (Croatie, Albanie) ou participer à ses instruments de politique
audiovisuelle (Moldavie, Arménie, Ukraine...), ainsi que sur d’autres pays tiers du Cambodge au
Népal. Les Commissaires européens au commerce et à la culture, les pays européens sensibles à cette
question comme la France, font valoir auprès des pays candidats l’incapacité dans laquelle ils se
trouveraient de développer une politique de soutien à leur audiovisuel, de participer à la politique
audiovisuelle de l’Union ou de conclure des accords de coopération bilatérale avec l’Union ou d’autres
pays s’ils devaient s’engager à libéraliser à l’OMC leur secteur audiovisuel. Ironie de l’histoire : en
défendant la capacité de ces pays à développer des politiques culturelles, l’Union se voit reprocher
d’être à contre-courant de la logique de l’OMC puisqu’elle subordonne son accord à l’absence
d’engagements de libéralisation et à l’introduction d’exemptions NPF dans les secteurs culturels.
In fine se dessine à l’OMC un rapport de force entre les pays qui soutiennent les positions de
l’exception culturelle, et les pays qui ont libéralisé leur audiovisuel, la balance penchant largement en
faveur des premiers.
L’adhésion de plusieurs pays européens de l’Est à l’OCDE offrit également l’occasion d’un
affrontement en vase clos sur les questions audiovisuelles. Cette organisation de pays développés
fonctionne dans certains secteurs comme une mini OMC avec des règles de libéralisation qui ont une
force juridique, la différence étant que l’OCDE ne dispose pas de mécanisme de règlement des
conflits. Parmi ces règles figurent le « code des invisibles » qui prévoit la libre circulation des
services. Le secteur audiovisuel est concerné puisque ces dispositions s’appliquent à « l’exportation,
l’importation, la distribution de films et autres enregistrements pour les salles ou la télévision ».
Serait donc interdite l’instauration de quotas à la télévision. Sauf - et le code des invisibles le spécifie -
pour les Etats membres formant une Union douanière.
Ce qui est évidemment le cas des Etats membres de l’Union européenne, mais moins nettement celui
des pays candidats à l’Union. Les Américains se sont engouffrés dans ce flou juridique pour inviter la
Pologne, la République tchèque et la Hongrie à prendre des engagements de renoncement à instaurer
tout quota de diffusion dans leur législation audiovisuelle, avec un luxe de détails que seuls des
spécialistes de la législation européenne (que n’étaient pas encore à l’époque les administrations des
pays de l’Est) pouvaient prévoir. Aussi, lorsque dans le cadre du processus d’élargissement, les
services de la Commission négocièrent en 1998 l’intégration de la directive TVSF, ils se virent
signifier par des Polonais plutôt gênés que la Pologne ne pourrait pas avancer sur ce chapitre en raison
des engagements qu’elle était en train de prendre en vue de son entrée à l’OCDE. Ces engagements
portaient sur le renoncement à toute instauration de quotas télévisés ayant pour but de promouvoir les
œuvres polonaises et européennes. Et le projet de loi sur l’audiovisuel que la Pologne allait adopter,
respecterait les engagements pris à l’OCDE de non discrimination et de totale libéralisation.
L’alerte était chaude. Contact fut aussitôt pris par la Commission avec la Belgique qui assurait à ce
moment la présidence de l’Union. L’ambassadeur belge à l’OCDE convoqua immédiatement une
réunion de coordination des Etats membres de l’Union européenne membres de l’OCDE pour préparer
la réunion de l’OCDE où devait être examiné et entériné le rapport relatif aux engagements de la
Pologne dans le cadre du Code des Invisibles. La Commission y présenta les modifications nécessaires
correspondant à l’obligation de la Pologne de s’aligner sur l’acquis communautaire, y compris dans le
domaine audiovisuel, en vertu de l’accord européen d’association signé avec l’Union et antérieur au
Code et du processus d’élargissement de l’Union. Ces modifications furent approuvées expressément
par tous les représentants des Etats membres de l’Union, sans opinion dissidente. Elles furent
transmises ensuite aux autorités tchèques et hongroises, qui vis-à-vis de l’OCDE s’étaient engagées
dans la même voie que la Pologne.
Ainsi, lors des réunions de l’OCDE où devaient être confirmés les engagements de ces pays, les
représentants de l’Union obtinrent-ils que ces promesses soient réexaminées à la lumière des autres
engagements internationaux et notamment européens des pays concernés.La fermeté porta ses fruits.
La Pologne reformula son projet de loi pour y inclure les fameux quotas, la République tchèque fit de
même, la Hongrie hésita davantage mais s’engagea à ce que tout soit en ordre avant la date de
l’adhésion.
Avec le conflit de positions de l’Uruguay Round et le conflit de mouvement à l’occasion des
accessions des nouveaux pays à l’OMC ou à l’OCDE s’achève une première phase de l’histoire de la
diversité culturelle. Au cours de cette phase réactive et défensive où fut préservé l’essentiel : la liberté
d’action des Etats en faveur de leur culture.
Ce premier acte de l’exception culturelle révèle que l’affirmation de cette notion a été surtout le fait
des politiques en réaction aux partisans d’une intégration de la culturedans le jeu des échanges
marchands et dans le processus de libéralisation de l’économie mondiale.
Cette volonté d’intégration a été portée notamment par les majors des industries culturelles (et de
télécommunications) considérant les mécanismes publics mis en œuvre par les autorités nationales
pour promouvoir leur culture comme autant d’obstacles à leur développement transnational.
Si l’on prônait cette voie, si l’on prétendait que cette intégration était de nature à procurer à la
collectivité mondiale dans son ensemble un optimum en termes de bien être culturel, alors il aurait été
logique de poser la question de ses « fondamentaux théoriques », bref d’en apporter la démonstration
théorique. Cela ne fut pas fait, et pour cause.
LA CULTURE AU RISQUE DU MARCHE
Les relations entre culture et économie ont donné lieu à des investigations intellectuelles
remarquables notamment depuis la montée en puissance des industries culturelles et la constitution de
groupes culturels importants nationaux et internationaux. Ces travaux sur l’économie de la culture ont
porté sur les déterminants de l’offre et de la demande de biens et services culturels, la formation des
prix compte tenu des interventions de l’Etat (régulation et subventions), les économies d’échelle et les
tendances à la concentration des industries culturelles. Ces travaux souvent complexes notamment à
cause de la difficulté de délimiter les contours de la culture, ont fait apparaître la part notable et
croissante occupée par les activités culturelles dans le Produit intérieur brut et dans l’emploi. Avec
pour corollaire la question : Quel est, du marché ou de l’Etat, l’élément déterminant de
l’investissement culturel ? Une des spécificités de la culture est que ce domaine ne peut pas ne pas
combiner les deux. En raisonnant aux extrêmes et de façon schématique, on peut dire que le « tout
marché » conduirait à n’investir que dans les productions culturelles rentables, laissant de côté les
secteurs et les créations sans avenir économique immédiat. Il s’ensuivrait des tendances à la
standardisation et à la concentration qui, pour limiter le risque lié à la création culturelle, la réduiraient
à la portion congrue ou l’accompagneraient d’un effort de marketing tel qu’il « forcerait » la demande
à s’y porter (demande qui se détournerait alors des autres créations plus modestement proposées). Les
caractéristiques d’un tel modèle se retrouvent d’ailleurs parfois dans certains secteurs à travers le
monde.
A l’autre extrémité, « le tout Etat » conduirait à faire dépendre les choix de l’investissement et du
financement culturel du seul « politique », avec le risque de générer une culture officielle et de
privilégier au nom de ces choix tel ou tel secteur de la culture au détriment des autres. Ainsi
contrairement à d’autres fonctions collectives (santé, éducation) que la collectivité peut décider de
confier au seul Etat, un consensus récent construit autour de l’idée que la culture a pour spécificité de
mêler nécessairement interventions de l’Etat et mécanismes de marché.
Cette recherche d’un point d’équilibre entre Etat et marché se retrouve naturellement au plan
international.
Le GATT puis l’OMC s’appuient sur les théories du libre échange et les considérations tirées de
l’histoire économique selon lesquelles les réflexes protectionnistes des nations ont précipité le monde
industrialisé dans la grande dépression.
Ces théories remontent à Adam Smith et à David Ricardo. On se souvient de leur postulat de base :
l’échange international, l’ouverture des économies, la division internationale du travail avec pour
corollaire la spécialisation des économies sont source de productivité, de croissance et de prospérité.
Dans ces conditions, chaque pays a intérêt à se concentrer sur la production de biens pour lesquels il
possède un avantage comparatif. Aux facteurs de production de base : terre, travail, capital sera ajouté
le progrès technologique qui contribuera à modifier la donne des avantages comparatifs en permettant
de nouvelles économies d’échelle. La différenciation du cycle du produit selon les marchés expliquera
la stratégie des firmes internationales. La division internationale du travail induite par la spécialisation
des économies dans les domaines où elles sont les plus compétitives permet, selon la théorie, une
allocation optimale des ressources et une croissance économique bénéfique pour tous. Le
développement du commerce international et donc la libéralisation des économies sont les pré-conditions essentielles de ce processus vertueux. D’où la mission de l’OMC d’assurer la libéralisation
toujours plus poussée des échanges commerciaux.
La question n’est pas ici de discuter du bien fondé de ces théories. Elle est de s’interroger sur le fait de
savoir - puisque certains pays veulent traiter de la culture à l’OMC - si elles sont applicables à la
culture. Autrement dit est-ce que le corpus théorique, les vertus du libre échange, auquel semblent
adhérer les Etats membres de l’OMC est valable pour la culture ?
La réponse est évidemment non. Que signifierait pour la culture le principe de spécialisation et de
division internationale du travail ? Cela signifierait que si un pays se trouve doté ou se dote de facteurs
de production exceptionnels pour la création théâtrale et a moins de dispositions pour la création
littéraire, il serait conduit à se spécialiser dans le théâtre et à renoncer à la publication de romans. Et
que le pays voisin qui connaît une situation inverse se spécialiserait dans les romans, les exporterait
dans le premier pays, et abandonnerait toute production théâtrale pour faire jouer chez lui les pièces et
acteurs du premier pays. Le simple jeu du marché conduirait selon ces principes à priver une
collectivité de son expression culturelle pleine et entière. Aussi petit soit-il, un pays doit évidemment
pouvoir conserver la capacité d’exprimer sa culture dans toutes ses acceptions.
Pour certains ce raisonnement pourrait être acceptable pour la culture traditionnelle (que signifie la
culture traditionnelle ?) mais ne devrait pas s’appliquer aux industries culturelles dont le
développement spectaculaire, s’explique par l’exploitation du marché mondial et la spécialisation qui
en résulte. Mais, en réalité, la concentration des industries culturelles sur un nombre restreint d’acteurs
mondiaux, et la spécialisation géographique qui l’accompagne, illustrent précisément l’incapacité du
marché à garantir simultanément création et diversité. Sans l’intervention des Etats pour soutenir leur
cinéma, les majors d’Hollywood déjà en situation dominante deviendraient l’acteur quasi-exclusif du
cinéma mondial, illustrant l’impossibilité d’appliquer à la culture le principe de spécialisation et de
division internationale du travail.
Ainsi les ressorts théoriques utilisés pour justifier le développement des échanges commerciaux ne
peuvent être retenus pour justifier la libéralisation par les règles du commerce des échanges culturels.
Et l’OMC n’est pas le cadre approprié pour traiter de la culture et des échanges culturels.
L’exception n’est pas française
Si au cours de la première phase de cette histoire de l’exception culturelle, il n’a pas été
produit de justification convaincante des effets du libre échange économique pour la culture, de son
côté la notion d’exception ou de diversité culturelle a engendré plus de confusion que de clarté
conceptuelle.
Pour une partie de l’opinion, la France ayant défendu et promu avec succès l’exception culturelle,
cette exception est devenue l’exception française. La politique culturelle et la culture françaises
seraient donc « exceptionnelles ».
L’équation avancée par certains : « exception culturelle = exception française », est d’ailleurs
contestable. Elle inclut dans l’exception - comme l’a fait Messier - toutes les composantes de la
politique culturelle française : le prix fixe du livre, les aides au cinéma, le régime des intermittents du
spectacle, le musée du Louvre....Mais elle confond ce faisant les politiques culturelles menées en
France par les pouvoirs publics, et la question de leur efficacité économique et sociale, avec la
question de la libéralisation des échanges. Certes la France peut se prévaloir d’une histoire et d’une
politique culturelle prestigieuses. Mais transformer ce modèle en exception est pour le moins abusif.
Au demeurant, cette politique est-elle vraiment exceptionnelle ? Est-ce en France que le taux de lecture dans la population est le plus élevé, que la pratique d’un instrument de musique est la plus
répandue, que le taux d’analphabétisme est le plus bas ?
Prôner la diversité culturelle n’est en aucun cas faire de la situation et des pratiques françaises un
modèle qui pourrait être brandi comme un oriflamme aux yeux de l’étranger. La France a tout à gagner
à travailler avec ses partenaires pour que leur conception commune de la diversité l’emporte, dans la
voie d’un nouvel universalisme assurant une place particulière et distinctive aux activités culturelles
au regard des règles que le libre échange - à l’intérieur des Etats et entre les Etats - prescrit aux
relations économiques. Heureusement cette attitude a été et reste celle des autorités publiques et des
principaux acteurs culturels français.
La diversité, valeur universelle
C’est dans cette voie universaliste que s’engagèrent les partisans de la diversité culturelle à
partir de 1999, ouvrant ainsi une deuxième étape de l’histoire de l’exception culturelle. Celle-ci verra
se préciser le concept de diversité et apparaître une volonté d’en faire une pierre angulaire des
relations internationales. C’est la ministre canadienne Sheila Cops qui la première lança le mouvement
en invitant les ministres de la culture des cinq continents à créer un Réseau International sur la
politique culturelle RIPC dont le premier objectif était de « faire en sorte que la diversité culturelle et
linguistique fasse partie intégrante de la réflexion mondiale sur le développement » et qui joua un
grand rôle dans la popularisation de ces idées.
Cette stratégie internationale trouva, notamment grâce aux efforts des gouvernements français et
canadien, un premier débouché concret avec la Déclaration Universelle sur la Diversité culturelle
adoptée par l’Unesco en octobre 2001. Cette Déclaration constitue la première formalisation du
contenu et des moyens du concept de la diversité culturelle, fondée sur l’affirmation des principes
suivants :
• Elle constitue le patrimoine commun de l’humanité. Elle est pour le genre humain aussi
nécessaire que l’est la biodiversité dans l’ordre du vivant »
• La défense de la diversité culturelle est un impératif éthique inséparable du respect de la
dignité de la personne humaine. Elle implique l’engagement de respecter les droits de
l’homme et les libertés fondamentales,
• Les droits culturels sont partie intégrante des droits de l’homme,
• Les biens et services culturels, porteurs d’identité, ne doivent pas être considérés comme des
marchandises ou des biens de consommation comme les autres,
• Il revient à chaque Etat, dans le respect de ses obligations internationales, de définir sa
politique culturelle et de la mettre en œuvre par les moyens d’action qu’il juge les mieux
adaptés...
Bien entendu, cette Déclaration n’avait pas force juridique, mais avec son adoption les partisans de la
diversité culturelle marquaient un point important. La diversité culturelle affirmait son évolution vers
la construction d’un droit positif international (évolution amorcée par l’Union européenne dans son
Traité). La Déclaration était d’ailleurs assortie d’un Plan d’action qui prévoyait modestement
« d’avancer la réflexion concernant l’opportunité d’un instrument juridique international sur la
diversité culturelle ». A l’occasion d’une réunion à Paris en février 2003, coprésidée par Sheila Cops
et Jean-Jacques Aillagon,, les ministres de la culture du réseau « RIPC » effectuèrent une démarche
auprès du directeur général de l’Unesco pour demander à cette organisation d’engager les travaux en vue de la réalisation de cet instrument légal. Ce processus, appuyé par la Commission européenne qui
en août 2003, dans une Communication officielle enjoignit les Etats membres de l’Union de s’y
impliquer et de le soutenir, fut couronné de succès. Le 17 octobre 2003, l’Assemblée générale de
l’Unesco décide d’ouvrir les travaux devant conduire à l’adoption d’un instrument juridique
international sur la diversité culturelle.
Culture et mondialisation : deux visions du monde
C’est bien de droit positif dans la sphère culturelle dont avaient besoin les partisans de la diversité
pour faire pendant au droit commercial international de l’OMC. Dans la préparation des réunions
ministérielles de Seattle (1999) puis de Doha (2000) qui devaient lancer un nouveau cycle de
négociations, le débat avait en effet ressurgi.
Dans les mois qui précédèrent Seattle, plusieurs pays estimèrent qu’il convenait d’aborder la question
de la diversité culturelle dans le nouveau cycle de négociations qui s’annonçait. Avec des arrièrespensées
différentes : les Canadiens pour en garantir l’exercice, d’autres pour enfoncer un coin et
affirmer la compétence de l’OMC dans le domaine culturel, c’est-à-dire déterminer ce qui est culturel
et ce qui ne l’est pas, et quelles sont les politiques publiques qui dès lors seraient légitimes. C’était le
sens de la proposition américaine.
Les pays proches de la position américaine considéraient que si la diversité culturelle est une
préoccupation légitime, les échanges culturels relèvent des mécanismes de l’OMC, même si ils
doivent être aménagés pour l’occasion, que l’affirmation de la diversité ne doit pas être la justification
d’une attitude protectionniste, qu’il existe une dimension économique des activités culturelles et que
pour lutter contre ce protectionnisme l’OMC est la meilleure parade.
Les partisans de la diversité, parmi lesquels l’Union européenne répliquèrent que traiter des questions
culturelles à l’OMC reviendrait in fine à faire décider par des panels ce qui est culturel et ce qui ne
l’est pas, et à soumettre les politiques culturelles des Etats membres au jugement de ces panels, sur des
critères qui seraient des critères commerciaux. On ajouta du côté européen que le procès en
protectionnisme fait à l’Europe par les Américains était quelque peu surréaliste dans la mesure où
leurs films occupent 70% du marché européen alors que les films européens occupent moins de 4% du
marché américain.
Mais, dans ces échanges, les tenants de la diversité culturelle sentaient bien que leur position pourrait
être progressivement grignotée à l’OMC par une inclusion dans les négociations de certains domaines
touchant de loin puis de plus près aux activités culturelles et audiovisuelles et par un alignement
croissant des pays membres sur les positions des Etats-Unis qui, comme chacun le sait, ne sont pas
dénués de moyens de pression. Un exemple de ce risque de grignotage fut, au sein de l’Union, la
tentative conduite par le Royaume-Uni et les Pays-Bas (l’Allemagne un moment intéressée ne se
manifesta plus) d’exempter la musique de « l’exception culturelle-audiovisuelle » européenne. Cette
tentative tourna court et, devant l’opposition de plusieurs pays et de la Commission, ne fut même pas
traitée au niveau ministériel. Autre exemple : la position américaine de considérer les films et œuvres
audiovisuelles transmis par l’Internet comme des « biens virtuels », leur appliquer les règles valables
pour les biens - et non pour les services - et donc de rendre caduques les exemptions prises par
l’Europe. Cette dernière réfuta la demande américaine.
Il était clair que la guérilla anti-« diversité culturelle » se poursuivrait, et que dans cette perspective, il
convenait en premier lieu de consolider les positions et en second lieu, puisque la nature des relations internationales a - elle aussi- horreur du vide, « inventer » de nouveaux dispositifs internationaux
apportant une sécurité juridique à la diversité culturelle, faute de quoi l’OMC finirait par traiter
progressivement des échanges culturels et s’ériger en juge de ce qui est culturel ou pas.
L’exception culturelle et l’OMC
Le mandat, donné par le Conseil de l’Union au négociateur européen dans la perspective du
nouveau cycle de négociations multilatérales lancé à Doha en novembre 2002, prévoyait de ne rien
négocier qui puisse remettre en cause « la possibilité, pour la Communauté et ses Etats membres, de
préserver et développer leurs politiques culturelles et audiovisuelles, pour la préservation de leur
diversité culturelle ». Ce mandat était conforme à l’acquis de l’Uruguay Round et aux nouvelles
dispositions du Traité enjoignant l’Union à « respecter et promouvoir la diversité de ses cultures. »
Les négociations sur les services, en cours à l’OMC, se déroulent en plusieurs phases. La première
prévoit que les Etats membres adressent aux autres des requêtes de libéralisation de leurs secteurs des
services. Dans la seconde, chacun fait ses offres. Et la dernière phase voit la négociation globale
s’engager à partir des requêtes et des offres, étant donné qu’à la fin, il faut être d’accord sur
l’ensemble. Conformément à la ligne retenue et au mandat donné, le négociateur européen ne souhaita
pas aborder la question de la diversité culturelle à Doha et ne fit aucune offre ni aucune requête de
libéralisation dans le secteur des services audiovisuels.
Cependant l’affaire n’en était pas close pour autant. Les négociations sur les services virent l’irruption
d’un nouvel acteur dans le débat sur la diversité culturelle : les pays en développement ou dits
émergents. A la date du 30 septembre 2003, dix-sept pays avaient déposé des requêtes à l’Union
européenne pour qu’elle libéralise son audiovisuel, parmi lesquels le Brésil, la Chine, la Corée, la
Jordanie, le Guatemala, le Nicaragua, la République Dominicaine, Taiwan, l’Uruguay, le Mexique,
l’Inde, le Mali, le Pérou...
Au-delà des pressions ou des promesses faites par les Américains pour engager ces pays dans la voie
de la libéralisation du secteur audiovisuel, au-delà de l’élément tactique de négociation que
représentent ces requêtes adressées à l’Europe (auxquelles on sait ou l’on suppose qu’elle ne donnera
pas suite et qui devra donc faire des pas supplémentaires pour ouvrir son marché dans d’autres
secteurs), c’est un message clair envoyé aux Européens et à tous les partisans de la diversité culturelle.
Ce thème sera repris par plusieurs intervenants en février 2003 à Paris lors de la réunion des ministres
de la Culture du réseau RIPC, le ministre du Burkina affirmant que « tout le monde parle de diversité,
mais personne ne parle de solidarité », celui d’Afrique du Sud demandant que les initiatives sur la
diversité culturelle « contribuent au développement culturel dans nos pays pour combler le fossé
culturel », et d’autres regrettant que la question de la diversité apparaisse trop comme une affaire de
pays riches voulant protéger leurs marchés.
A juste titre, et sous la pression des pays en développement, la question de la diversité culturelle
s’étendait à celle des échanges culturels et au rôle que les pays riches pouvaient jouer en faveur
d’échanges culturels plus équilibrés au plan mondial. C’était même une condition sine qua non pour
que ces pays se sentent partie prenante de la démarche visant à établir une convention internationale de
la diversité culturelle sous l’égide de l’Unesco appelée à « être à la culture, ce que l’OMC est au
commerce », selon les mots de la ministre canadienne Sheila Cops.
En raison du développement des négociations sur les services à l’OMC, il devenait en il devenait en effet urgent de
donner à la question des échanges culturels internationaux une perspective de traitement autre que
celle strictement commerciale des accords commerciaux internationaux.
Pourquoi a-t-on besoin d’une convention internationale ?
Les relations entre le marché et les préférences collectives exprimées par les sociétés qui les
conduisent à réserver tel ou tel domaine à l’intervention publique ou à encadrer le jeu du marché dans
d’autres domaines afin d’y faire valoir également l’intérêt général, ne concernent pas seulement la
culture.
Elles concernent aussi les normes sociales, la santé et l’environnement.
Dans le champ culturel et à l’exception des conventions sur les droits d’auteur dont l’articulation avec
l’OMC renvoie aux accords sur la propriété intellectuelle, il n’existe au regard des règles
commerciales ni référent (valeurs, principes, objectifs) ni texte normatif. D’où le projet de faire jouer à
l’Unesco ce rôle et de disposer d’une convention internationale ayant force de loi.
L’objectif d’un instrument international sur la diversité culturelle est clair : il s’agit sur la base de la
reconnaissance de la spécificité des biens et services culturels d’assurer la permanence, la légitimité et
donc la sécurité juridique des politiques actuelles ou futures mises en œuvre par les Etats pour la
préservation de leur patrimoine et le développement de leurs expressions culturelles. Ainsi cet
Instrument garantirait-il ces interventions au regard des objectifs et accords de l’OMC qui visent à une
libéralisation toujours plus poussée et sans retour des marchés de biens et de services dans le monde.
Cela reviendrait-il à considérer comme a priori légitime toute initiative d’un Etat prise au nom de la
culture ?
A l’évidence non, et ceci pour trois raisons :
• les définitions de la culture sont floues et variables selon les pays. On se souvient du Japon
voulant protéger son marché au motif que son riz devait avoir été produit selon certaines
méthodes traditionnelles. La tradition ne saurait constituer en soi une préférence constructive.
• certaines mesures peuvent être incompatibles avec les droits de l’homme. Lors de la rédaction
des conclusions du sommet de Johannesburg sur le développement durable en septembre
2002, des organisations féministes s’opposèrent à un paragraphe ambigu qui aurait pu
légitimer au nom de la diversité culturelle, certaines pratiques comme l’excision. Il est donc
important d’affirmer, comme l’ont fait l’Unesco dans sa déclaration universelle sur la diversité
et la Commission européenne dans sa communication que la légitimation des politiques ou
pratiques culturelles ne saurait contrevenir aux droits de l’homme.
• enfin parce que s’agissant de la promotion de la diversité culturelle, cet instrument devrait, audelà
de son rôle de sécurisation juridique des politiques culturelles, promouvoir les échanges
culturels à travers le monde et veiller à ce que leur développement se fasse de façon
équilibrée. Il n’y a pas en effet pas de diversité sans échanges, et la culture ne peut être
cloisonnée et limitée dans son rayonnement géographique. Toute l’histoire culturelle montre
combien la création intellectuelle et artistique est le fruit d’influences diverses, de courants
croisés. Dans ces conditions, des mesures nationales établissant par exemple des quotas
nationaux (70-80%) à un niveau tel, que les échanges en seraient pénalisés ne pourraient
recevoir la légitimation de la Communauté internationale.
 Ce qu’une Convention internationale sur la diversité doit dire.
Ce qu’une Convention internationale sur la diversité doit dire.
Pour être crédible et jouer face à l’OMC un rôle de référent, le futur instrument international
devrait comporter trois dimensions : l’affirmation des droits culturels, la régulation de la diversité et le
développement d’échanges culturels équilibrés conditions d’un dialogue interculturel vivant.
S’il n’apparaît pas - a priori - trop difficile de définir et consolider au plan international dans un
instrument juridique les droits culturels, la façon de faire respecter ces droits et de garantir la
préservation et la promotion de la diversité culturelle apparaît, elle, plus ambitieuse mais plus
problématique. C’est pourquoi la communauté internationale devrait se réserver une capacité
d’évaluation des dispositions prises par les Etats dans le domaine culturel.
La régulation au plan international des politiques culturelles afin d’assurer le respect des trois
conditions précitées (champ d’application, droits de l’homme, échanges culturels équilibrés) est à
construire. Cela prendra sans doute du temps et lors des travaux préparatoires à l’Unesco de
l’instrument international pourrait être suggérée une première étape : celle de la mise sur pied d’un
observatoire international qui aurait pour but de formuler des recommandations sur base d’indicateurs
de la diversité culturelle. Dans cette perspective l’expérience européenne pourrait s’avérer précieuse et
notamment l’application, qu’elle pratique de longue date, du principe de proportionnalité des mesures
publiques au regard des objectifs poursuivis.
Pour assurer l’articulation nécessaire de la Convention internationale sur la diversité avec les accords
commerciaux gérés par l’OMC, l’Observatoire pourrait dresser une typologie des mesures
d’intervention culturelle ayant un impact sur le commerce (accords bilatéraux, préférences nationales
ou régionales, règles d’accès au marché garantissant le pluralisme...). Les Etats et les organisations
comme l’Union mettant en œuvre ces instruments légitimés par la Convention internationale seraient
alors dans une position telle à l’OMC qu’aucune requête de libéralisation et aucun accord commercial
ne pourraient leur être opposés dans le domaine couvert par les mesures mises en œuvres.
Enfin l’Observatoire pourrait dresser un état des lieux des échanges culturels entre pays et en
particulier entre pays du Nord et du Sud et faire des recommandations aux Etats pour qu’ils redressent
des situations déséquilibrées et intègrent davantage la culture dans leurs relations bilatérales ou
multilatérales et, pour les pays du Nord, la prennent davantage en compte dans leurs instruments
d’aide au développement. Trop souvent les politiques de coopération de ces Etats se résument à des
politiques d’influence culturelle distillant les effluves d’une nostalgie d’empire. Un redéploiement de
ces politiques en faveur de l’aide aux expressions culturelles locales, au développement des échanges
culturels et du dialogue interculturel traduirait concrètement l’engagement des pays du Nord envers la
diversité et l’équilibre des relations culturelles. Le signal ainsi donné permettrait d’impliquer
davantage les pays en développement ou émergents dans la problématique de la diversité culturelle et
de leur offrir des perspectives que certains d’entre eux ont la tentation de rechercher du côté de
l’OMC
PROPOSITIONS POUR UNE POLITIQUE DE CONTENUS
La notion de diversité culturelle a, jusqu’à présent, exprimé davantage une posture face aux
accords commerciaux internationaux qu’elle n’a caractérisé un contenu de politique culturelle. Peu
d’initiatives et d’actions nationales dans le domaine culturel ont été prises en raison de l’objectif de la
diversité culturelle. Comme si cet objectif était retenu uniquement dans le but de préserver sa capacité d’action dans le domaine culturel et que derrière ce paravent sécuritaire les choses pouvaient se
poursuivre sans changement.
Pourtant, la revendication de la diversité ne saurait être confinée à la sphère internationale. Les raisons
qui ont conduit une grande partie des nations à revendiquer une mondialisation respectueuse de la
diversité de leurs cultures, sont en effet les mêmes qui devraient les inciter à intégrer cette dimension
dans la politique culturelle qui relève de leur responsabilité.
En Europe, cinq tendances mettent en jeu la diversité culturelle et les moyens traditionnels de
l’intervention de la puissance publique dans le domaine culturel :
• La concentration des industries culturelles
• Le resserrement de l’offre culturelle dans certains secteurs
• Le pluralisme des sociétés
• La construction politique de l’Europe
• La mondialisation.
Ces tendances appellent delapartdesEtatsuneapprocheetdes instruments de type nouveau afin de
faire respecter et promouvoir la diversité, la « nouvelle politique » ayant alors pour finalité d’assurer la
plus grande égalité des chances face à la création, la production et la distribution d’œuvres culturelles,
de favoriser l’accès du public à la variété la plus large d’œuvres culturelles, ainsi que les échanges
culturels et la circulation des œuvres entre nations dans le but de renforcer la connaissance mutuelle et
le dialogue interculturel.
Prendre en compte la diversité culturelle dans l’examen des projets de concentration
Les concentrations observées entre les entreprises culturelles représentent le défi le plus important
pour la diversité culturelle. Quand sept majors du cinéma - toutes américaines - se partagent 80% du
marché mondial, quand cinq majors de la musique (dont deux européennes EMI et BMG) effectuent
80% de la distribution mondiale de productions musicales, quand les éditeurs de livres se concentrent
au point qu’en France la même entité VUP-Hachette risque de contrôler 50% des points de vente et
75% de la distribution nationale, il y a de quoi s’inquiéter pour le pluralisme culturel et l’avenir de la
création indépendante [2].
Le degré de concentration est variable selon les secteurs culturels : faible là où les gains en termes
d’économie d’échelle sont limités (arts vivants, spectacles, bibliothèques classiques, festivals,
patrimoine), plus fort là où ces gains sont potentiellement importants et donc recherchés (industries
culturelles de l’édition, du disque, de l’audiovisuel). Dans ces derniers secteurs, particulièrement
concernés par la mondialisation, la concentration est souvent justifiée par le fait que l’offre de biens et
services culturels est aléatoire et risquée : ce sont des industries de prototypes, sur fond de concurrence intersectorielle forte et de produits substituables dans l’espace-temps où ils sont consommés (musique
/ livre / cinéma / TV / Internet...).
La volonté des opérateurs de réduire ce risque conduit à des concentrations horizontales. Celles-ci
permettent d’adosser des activités de production culturelle à des activités moins aléatoires (industries
du bâtiment, de distribution d’eau...) ou au développement jugé plus rapide (télécommunications,
Internet...). Ces mêmes opérateurs ont également recours à des concentrations verticales dans le souci
de maîtriser la distribution qui apparaît de plus en plus comme le chaînon essentiel de la chaîne de
valorisation.
Il y a dans ce mouvement, la recherche classique - comme pour les autres secteurs capitalistiques - de
marges fortes, mais aussi le désir et la nécessité de lancer de nouveaux talents, de nouvelles œuvres,
bref de financer l’activité de création.
Toute la question est de savoir où se trouve le point d’équilibre entre la logique capitalistique et la
logique de création. Quand la première l’emporte, on observe un resserrement de l’offre culturelle sur
un nombre limité de produits culturels plus ou moins formatés, vendus au public à grand renfort de
démarche marketing et de publicité. L’offre façonne alors la demande. Elle occupe l’espace au
détriment des productions d’opérateurs indépendants, pour lesquels l’accès au marché s’avère de plus
en plus onéreux. Dans le cinéma, les films européens ont du mal à trouver des écrans, ceux-ci étant
largement occupés par les films des majors américaines. Le budget marketing d’un film américain est
désormais égal à son coût moyen de production, lui-même cinq fois supérieur à celui d’un film
européen.
Bien que la diversité culturelle puisse être sérieusement mise à mal par ces mouvements de
concentration, ceux-ci continuent à n’être évalués, autorisés ou interdits par les instances
juridictionnelles compétentes qu’à partir des seules règles de la politique de concurrence : ententes sur
les prix préjudiciables aux consommateurs, position dominante préjudiciable au jeu de la concurrence
dans le secteur concerné.
Or, les décisions rendues devraient intégrer des décisions de politique culturelle à travers l’examen des
conséquences d’un mouvement de concentration sur la diversité culturelle.
Il serait donc souhaitable qu’au plan national soit crée un organisme d’évaluation culturelle dont l’avis
conforme serait nécessaire pour valider un processus de concentration ou une entente impliquant les
industries culturelles.
Dans le domaine audiovisuel un premier pas a été franchi en ce sens avec l’avis consultatif que doit
donner le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel sur les opérations d’achat ou de fusion. Au niveau
européen, c’est le collège des Commissaires qui statue in fine sur les décisions de politique de
concurrence, et dans cette configuration la voix du Commissaire à la Culture vaut celle du
Commissaire à la Concurrence. Il est même arrivé que le Collège suive la Culture plutôt que la
Concurrence. Ce fut le cas avec la décision de la Commission de ne pas interdire les systèmes
allemands et autrichiens de prix fixe du livre (décision du 14/7/1999). De même la Commission a-telle
suivi davantage les arguments du Commissaire à la Culture dans les affaires mettant en cause le
service public de télévision, qui fut dès lors préservé.
Il reste que l’instruction de ces affaires tant au plan national qu’européen, suit de façon privilégiée les
canons de la concurrence et ne s’intéresse guère au « contenu culturel » des opérations en cause.
L’organisme d’évaluation culturelle chargé de délivrer un avis conforme devrait alors disposer d’une
batterie d’indicateurs à la fois quantitatifs et qualitatifs sur la problématique de la diversité dans les différents secteurs culturels. En effet, les statistiques dont on dispose dans ce domaine sont surtout
d’ordre quantitatif et centrées sur les pratiques culturelles (fréquentation des musées, nombre de titres
disponibles à la vente, box-office des films). Elles sont plutôt frustes quand elles traitent des structures
de production et de distribution (part de marché par opérateur, place respective des grandes surfaces et
du commerce de détail dans la vente de livres ou de disques...).
La nouvelle batterie d’indicateurs destinés à apprécier le degré de diversité présenté par les activités
culturelles, permettrait aux autorités compétentes de prendre les décisions permettant à l’occasion des
mouvements de concentration :
• d’assurer un équilibre entre majors et indépendants sur le marché, tant au niveau de la
production qu’à celui de la distribution,
• de garantir l’accès au marché pour l’ensemble des opérateurs,
• de tenir compte des impératifs de la création.
Aller plus loin dans le futur Traité de Rome
L’approfondissement et l’élargissement de l’Union appellent une redéfinition et un
repositionnement respectif des approches nationales et européennes dans le domaine culturel. Il serait
vain de promouvoir à l’échelle nationale une politique de diversité si la logique d’intégration de
l’Europe par l’économie devait dicter ses lois, c’est-à-dire privilégier le jeu du marché.
C’est pourquoi, il faudra essayer d’aller plus loin dans le futur Traité de Rome issu des travaux de la
convention.
Nous avons vu dans la première partie comment la directive TVSF parvint à concilier la libre
circulation des services et la préservation des mécanismes de soutien des Etats membres à
l’audiovisuel. Dans la quasi-totalité des cas traités par la Commission, les instruments de politique
culturelle et audiovisuelle ont ainsi été respectés et juridiquement consolidés. Mais dans l’état actuel
des textes du Traité, il reste que la culture est souvent placée sur la défensive, qu’elle doit se justifier
par rapport aux règles économiques. Ce n’est pas le cas dans les Etats membres, mais cela l’a été et le
reste au niveau européen, que ce soit pour la question du service public de télévision, pour celle du
prix du livre, des aides au cinéma.
Les propositions de la Convention présidée par M. Giscard d’Estaing en vue d’une future Constitution
européenne permettraient, si elles sont retenues, un meilleur équilibre. Les objectifs qui y sont
assignés à l’Union comportent le respect de « la richesse de sa diversité culturelle et linguistique ». La
diversité culturelle apparaît aussi dans la charte des droits fondamentaux de l’Union qui se voit dotée
d’une force juridique. Elle subsiste comme « clause horizontale » dans l’article consacré à la culture.
Les décisions au Conseil des ministres vont être simplifiées. Elles pouvaient déjà être prises à la
majorité qualifiée pour l’audiovisuel (directives TVSF ou sur les droits d’auteur, programme Media),
elles pourront l’être maintenant dans le domaine de la culture. C’est une excellente mesure : fini le
temps où un seul pays pouvait bloquer pendant deux ans l’adoption d’un petit programme de
traduction littéraire destiné à encourager la circulation des œuvres, ou limiter toute ambition
budgétaire pour la culture.
Dans la dernière ligne droite de la rédaction du projet de Constitution, un débat plutôt vif opposa
partisans du maintien de l’unanimité et partisans du passage à la majorité qualifiée pour les accords
commerciaux pouvant avoir des implications en matière audiovisuelle et culturelle. Au nom même de la défense de la diversité culturelle, les partisans de la majorité qualifiée estimaient que la règle de
l’unanimité bloquerait toute initiative offensive et pourrait être préjudiciable à la diversité. Autrement
dit, un seul pays pourrait entraver l’adoption d’un mandat de négociation favorable à la diversité
(comme celui adopté le 26 octobre 1999 pour les nouvelles négociations OMC) et bloquer toute
riposte ou réaction ferme de l’Union si un panel de l’OMC se voyait convoqué pour arbitrer une
question touchant à la culture ou à l’audiovisuel avec le but de la soumettre aux seules lois du marché.
Pour les partisans du maintien de l’unanimité le risque était exactement inverse. En cas de décision à
la majorité qualifiée, le pays le plus favorable à la diversité pourrait se retrouver minoritaire au sein du
Conseil et ne plus pouvoir bloquer une tentative qui viserait à faire de la culture et de l’audiovisuel des
objets de négociations. Entre les deux, d’autres intervenants dans le débat estimaient que l’on pourrait
passer à la majorité qualifiée -afin de pouvoir décider- à partir du moment où la nouvelle Constitution
de l’Union aurait promu le respect de la diversité au rang des valeurs et objectifs majeurs de l’Union,
et en aurait conforté la qualité de « règle de droit ».
La solution trouvée repose sur le principe selon lequel le mandat de négociation pourra être pris à la
majorité qualifiée, sauf si ce mandat venait à remettre en cause la diversité culturelle. Dans ce cas,
mais dans ce cas seulement, l’unanimité serait requise. En outre le Parlement européen participerait
désormais directement à la définition du mandat de négociation de la Commission.
Il est cependant un domaine où les travaux de la Convention sur la diversité culturelle ont été
insuffisants. C’est celui des aides d’Etat. On aurait apprécié qu’au lieu de se concentrer exclusivement
sur les conditions de vote du Conseil sur les accords commerciaux, le débat porte aussi sur cette
question des aides. En effet, le maintien du système actuel aboutit à considérer a priori comme
illégales les aides à la culture. D’où leur notification obligatoire par les Etats à la Commission qui doit
décider de leur compatibilité avec le Traité. Les aides à la culture sont ainsi considérées comme
suspectes par l’Europe. Cette question devrait être réexaminée dans le cadre de la CIG pour trouver un
modèle d’observation et de contrôle des aides qui corresponde à la spécificité de la culture. Après tout
il y a bien des régimes spéciaux pour l’agriculture ou les Transports. Dans ce domaine, le point de
départ est à l’inverse du régime réservé à la culture dans la mesure où les aides qui correspondent à
des missions de service public sont considérées comme compatibles avec le Traité. Au vu de
l’expérience et in concreto, cela ne réduirait pas le pouvoir de la Commission qui a jusqu’à présent
respecté la spécificité de la culture, mais cela améliorerait considérablement les relations de l’Union
avec les communautés culturelles qui vivent mal - et on les comprend- le fait d’être systématiquement
sous contrôle de l’Europe.
Sur cette base et à condition que l’affaire des aides publiques soit clarifiée, une complémentarité
devrait être recherchée entre politique nationale et politique de l’Union. Cette dernière aurait alors une
double mission :
• Agir en sorte que l’environnement législatif et réglementaire européen contribue effectivement à
l’épanouissement des cultures nationales et régionales. C’est-à-dire respecter dans son action la
diversité culturelle et conforter les mesures nationales prises à cette fin.
• Mettre en œuvre des moyens financiers conséquents pour favoriser la circulation des œuvres et des
artistes, la connaissance mutuelle des cultures. Le programme Media pour l’audiovisuel et Culture
2000 pour les activités artistiques et littéraires vont dans le bon sens. Mais leur budget qui
représente un pour mille du budget communautaire devrait être significativement renforcé pour
atteindre une masse critique.
Favoriser la circulation mondiale des œuvres
La réflexion engagée par la Communauté internationale sur la place et le rôle des échanges
culturels entre les nations n’en est qu’à ses débuts, comme on l’a vu au chapitre précédent avec les
travaux engagés sur ce sujet par l’Unesco. A terme, l’objectif ne devra pas être seulement de protéger
la culture des règles de l’OMC, mais de donner un véritable contenu à la diversité culturelle, et d’en
intégrer la problématique dans les relations culturelles extérieures.
Des pas ont été franchis dans cette direction, à travers la Convention de Cotonou signée entre l’Union
et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou dans le cadre du partenariat euroméditerranéen.
Ces initiatives ont eu l’avantage d’entrouvrir la porte, de faire prendre conscience du
déséquilibre des échanges et donc révéler l’urgence d’une véritable politique de diversité.
Prenons l’exemple du cinéma : la distribution dans les 15 pays de Union européenne des films des
continents autres que nord-américains est anecdotique : 19 films africains sur la période 1996-2002
réalisant 117 000 entrées, 91 films latino-américains sur la même période réalisant 9,8 millions
d’entrées, 57 films de pays méditerranéens réalisant 3,6 millions d’entrées. Soit en moyenne 2,1
millions par an, alors que le nombre d’entrées enregistrées dans l’Union par le 10ème film américain
au box office est de 18 millions. Les films d’Asie sont un peu mieux accueillis : les 200 films
distribués dans l’Union de 1996 à 2002 ont réalisé 55 millions d’entrées. Quant aux films des
continents autres qu’américain, diffusés par les télévisions européennes publiques ou privées, ils sont
pratiquement introuvables.
Pour que dans le secteur culturel également une mondialisation équitable prenne forme, il faut revoir
les instruments d’aide au développement que possèdent l’Europe et ses Etats membres, à la lumière de
l’objectif de la diversité culturelle. L’Union qui est en effet le premier intervenant mondial dans le
domaine de la coopération doit montrer la voie et intégrer pleinement la culture dans la stratégie du
« développement soutenable ».
Son action devrait de façon complémentaire :
• Contribuer à créer ou renforcer les infrastructures culturelles dans les Pays aidés et soutenir
leurs productions. Il s’agit ici de convaincre les pays bénéficiaires de consacrer une partie de
l’aide qu’ils reçoivent au titre du Fonds européen de développement à l’investissement
culturel et d’utiliser en soutien les instruments gérés directement par Bruxelles. Parallèlement
les programmes de formation européens pourraient être ouverts aux professionnels des pays
partenaires,
• Faciliter l’accès des œuvres et productions culturelles de ces pays au marché européen, en
favorisant non seulement leur exposition dans les salons, les marchés professionnels et les
festivals, mais aussi en incitant les opérateurs culturels européens, comme les télévisions
publiques ou les chaînes de distribution à leur donner la plus large audience possible.
Les politiques culturelles extérieures des Etats européens devraient elles aussi s’adapter aux exigences
d’une nouvelle mondialisation. Ces politiques souvent héritées de l’ère coloniale restent le plus souvent des politiques d’influence culturelle et linguistique. Les transformer en instrument d’un
authentique dialogue interculturel est l’enjeu de la décennie qui s’ouvre.
Combinant une partie des moyens européens et nationaux, et associant opérateurs européens et locaux,
des plates-formes de coopération pluridisciplinaire pourraient être organisées dans les pays partenaires
pour favoriser la connaissance mutuelle des œuvres et partager le savoir-faire en matière d’ingénierie
et de politique culturelle.
De même un dialogue structuré pourrait se tenir régulièrement entre ministres de la culture européens
et ministres des pays partenaires pour examiner la place de la culture dans les politique de coopération
et dans la stratégie internationale de développement durable.
Ce dialogue, cette concertation, entre responsables publics, opérateurs culturels avec la volonté de
mieux équilibrer les échanges culturels entre nations est un préalable à la mise en œuvre d’une
politique de diversité culturelle au plan mondial.
CONCLUSION
L’Union européenne a su faire respecter, depuis une dizaine d’années, sa conception de la
diversité culturelle. Elle a sur cette route rencontré des partenaires actifs et toujours plus nombreux, y
compris dans le camp anglo-saxon où l’Australie, l’Afrique du Sud, à l’exemple du Canada, ont
adopté une ligne assez ferme. Durant cette période, les Etats de l’Union européenne ont pu librement
développer leurs instruments de régulation et de soutien en faveur de l’audiovisuel et de la culture sans
être contraints en quoi que ce soit par les accords commerciaux internationaux. La politique
audiovisuelle et culturelle de l’Union a même été étendue aux pays candidats. Ce sont donc
aujourd’hui 28 pays qui respectent cet « acquis communautaire ».
La première phase de l’histoire de l’exception culturelle s’est terminée au bénéfice de l’Europe. La
France y aura joué un rôle moteur. Mais sans l’Union, sans par exemple l’engagement de la Belgique,
du Portugal, de l’Espagne, de l’Italie à l’époque et plus récemment de l’Allemagne et de l’Autriche
sans la Commission européenne, la position française aurait été bien fragile. Il est remarquable que les
trois Commissaires à la Culture qui se sont succédés depuis 1991 [3] aient assuré la continuité des
positions européennes.
De son côté, et même si ses compétences n’en font pas encore un co-décideur de la politique
commerciale, le Parlement Européen aura réussi à faire passer la question de l’exception culturelle
dans le débat public européen. Le débat entre les institutions et des organisations professionnelles
exigeantes et compétentes fut profond, suivi, parfois vif, et le résultat conforta l’intérêt commun
En dix ans, l’Europe est parvenue à faire d’un principe une règle de droit européen. Il lui faut
désormais en faire une politique. Y parviendra-t-elle ?